On estime que chaque année, en France, plus de 20 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont artificialisés, soit la superficie de 5 terrains de football par heure.
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé comme objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.
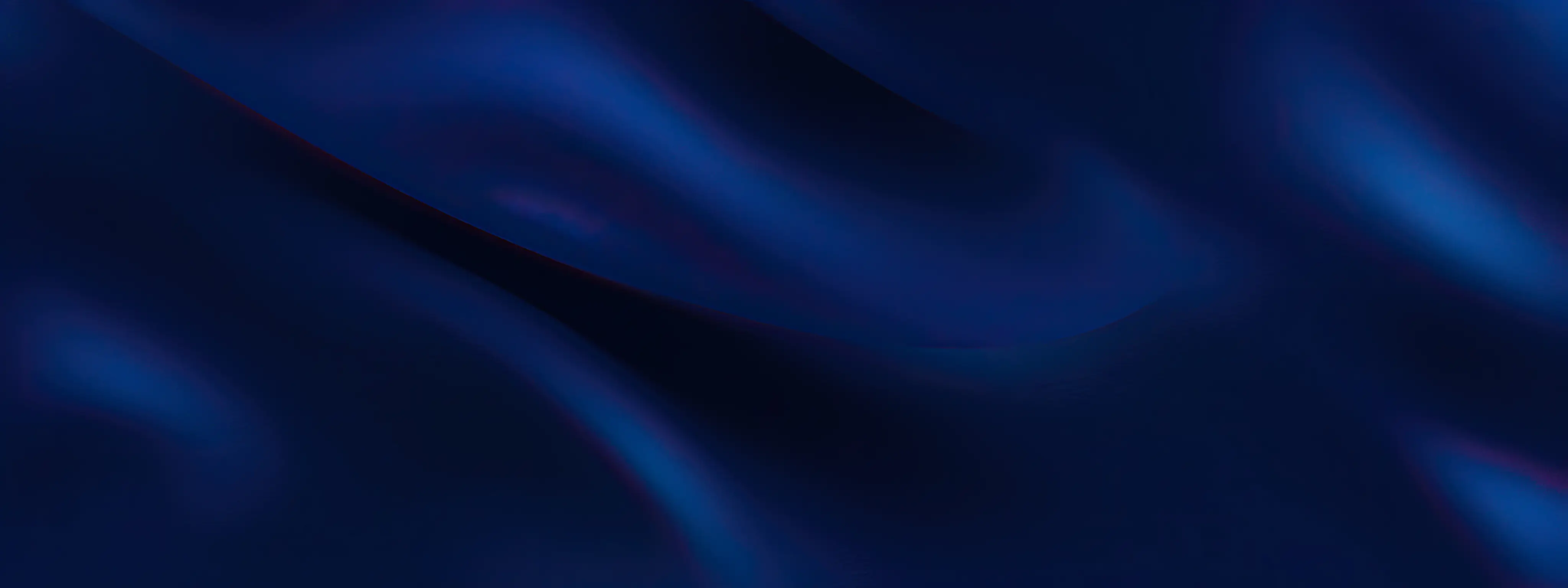
Besoin d’un conseil ?
Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expertCette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme, et doit être conciliée avec l'objectif de soutien de la construction durable et tenir compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial.
Néanmoins, cet objectif de « zéro artificialisation nette » est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
En effet « Si elle veut réellement obéir à une logique ‘nette’, l'équation du ZAN doit tenir compte des artificialisations résultant d'aménagements profitant également à d'autres collectivités que celles qui les accueillent.
Par exemple, il ne serait pas juste qu'une intercommunalité où s'implante un site d'enfouissement de déchets provenant majoritairement d'une autre région soit seule comptable de l'artificialisation qui en résulte.
De même, une communauté de communes accueillant un parc d'activités dont le rayonnement dépassera ses propres frontières doit pouvoir partager l'effort foncier qu'elle accomplit pour le bénéfice de toutes les collectivités voisines.
Autrement, de tels projets obéreraient les marges de consommation foncière des collectivités d'accueil de manière injuste en les privant de la possibilité d'aménager leur territoire pour satisfaire leurs propres besoins de développement […] »
Interpellé par une question en date du 03/10/2024
(voir Question de Mme Sylvie Valente Le Hir - Oise - Les Républicains-A)
le Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chargé de l'énergie est venu apporter le 23/10/2024 des éléments de réponse.
Quelles sont les possibilités de mutualisation du ZAN ?
« Les possibilités de mutualisation sont nombreuses.
Elles concernent les projets d'envergure nationale, dont la liste est fixée par arrêté - en général, il s'agit de gros projets industriels ou de recherche -, mais également des projets d'envergure régionale, les régions pouvant mutualiser la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, ou encore des projets d'aménagement, d'infrastructures et d'équipements publics identifiés au travers des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), et enfin des projets d'intérêt intercommunal, qui peuvent être mutualisés dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (Scot).
Des mutualisations sont ainsi possibles à trois échelles.
Pour améliorer la sobriété foncière, il est important de considérer chaque projet à son échelle territoriale […]
Pour faciliter le développement commun à ces différentes échelles, l'outil de planification doit être au service des élus […]
les services déconcentrés de l'État permettent l'accompagnement et la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes.
Il est également possible de s'associer aux conférences régionales de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols pour conduire ces discussions […] »
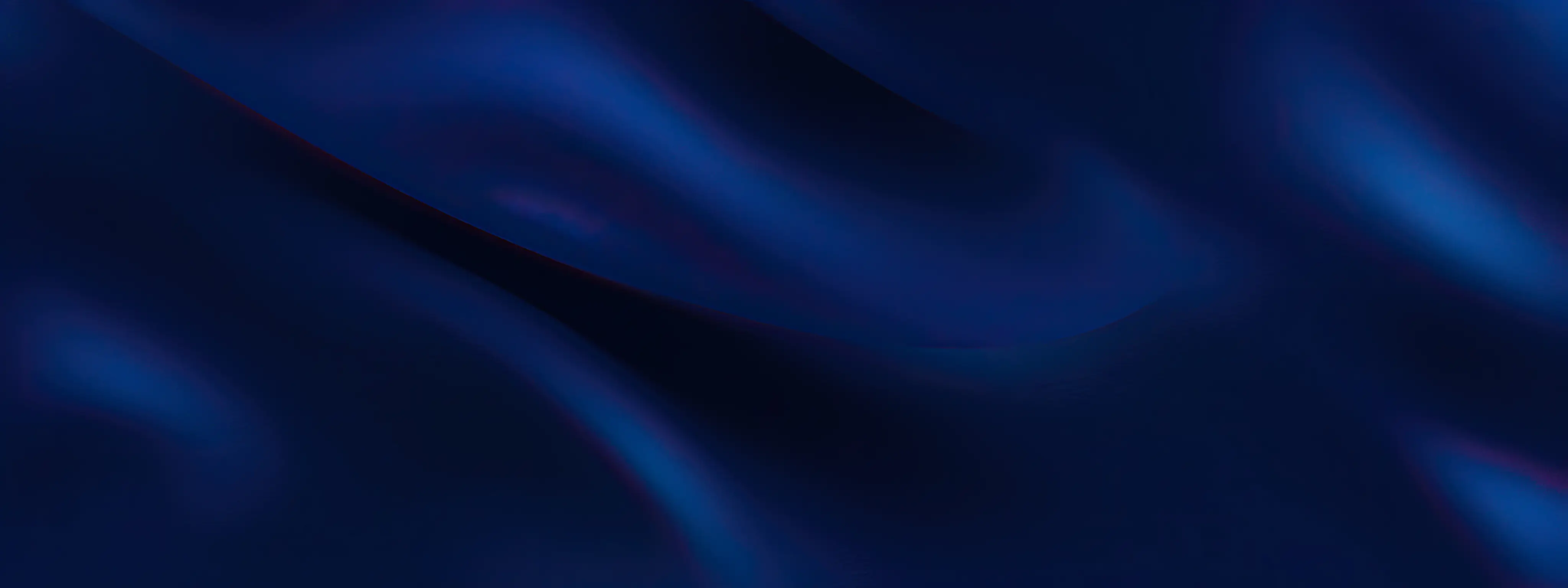
Besoin d’un conseil ?
Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expert


